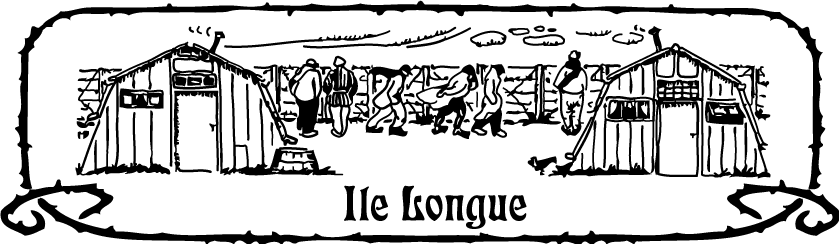Le texte de Hans Baehr, écrit il y a un peu plus de cent ans, présente un réel intérêt. C’est le récit des événements brutaux auxquels il a été mêlé de 1914 à 1917 avec toutes leurs conséquences directes et indirectes pour lui, souvent insupportables et même dramatiques. Il en rend compte dans un panorama complet, étalé dans la durée, et laisse percer ses craintes, son patriotisme, sa foi en la victoire et la supériorité de la culture allemande face entre autres aux Polonais et aux Français.
C’est le texte d’une conférence, il est donc destiné à être entendu. Écrit il y a maintenant cent ans, il est un peu touffu et a été rédigé en langage commun, c’est à dire quelquefois peu rigoureux. Pour en faciliter la lecture, j’ai cru utile de créer des intertitres, des paragraphes, de souligner les dates et de supprimer certains doublons.
Bonne lecture.
Daniel Priou
Au revoir l’Amérique
C’est le matin du 2 août 1914 que, au terrain de tennis, nous avons reçu par téléphone une invitation à nous rendre au Cercle Allemand de la capitale Mexico où son Excellence von Hintze, le Chargé d’affaires allemand de l’époque allait faire un exposé sur la situation politique européenne. Les informations parues dans la presse avaient déjà provoqué chez nous beaucoup d’émotion du fait de la dimension européenne de la brouille serbo-autrichienne et surtout germano-russe. Aucune information précise n’était parvenue à la légation de la part du gouvernement allemand et nous supposions que d’éventuels communiqués avaient pu être interceptés en cours de route. Quoi qu’il en soit, notre Chargé d’affaires avait obtenu du Chargé d’affaires russe la confirmation que l’Allemagne avait déclaré la guerre à la Russie. Il nous conseilla d’observer la plus grande prudence et d’avoir un comportement correct à l’égard des ressortissants des nations ennemies ; il nous fit savoir aussi qu’il avait l’intention de nous réunir à nouveau au Cercle Allemand dès qu’il aurait des informations plus précises sur les hostilités. Dans le même temps, la situation politique au Mexique s’était tellement dégradée que le gouvernement mexicain s’était vu dans l’obligation de faire savoir aux légations étrangères qu’il n’avait pas les moyens de continuer à protéger les étrangers des menées révolutionnaires. Deux zones de protection des étrangers avaient été constituées dont ils avaient à assurer eux-mêmes la défense. Nous les Allemands avions à défendre la première zone en commun avec les Japonais et l’autre devait être défendue par les Anglais et les Français ensemble. A la légation, on nous initia, nous les jeunes Allemands, au maniement du fusil Winchester, mais les choses n’allèrent pas jusqu’à des actions défensives parce que l’intérêt des étrangers pour ce qui se passait au Mexique retomba rapidement. Le seul objet de nos discussions et stratégies laborieuses était de savoir comment nous rendre en Europe. On commença par faire le projet d’utiliser un cargo espagnol parce que les bateaux allemands risquaient d’être interceptés. Pour la plupart, nous étions enclins à penser que cette guerre allait être l’une des plus terribles surtout si la France devait se trouver impliquée. L’Angleterre resterait neutre probablement pour profiter de la situation.
On croyait également que, dans ce contexte, la poudrière indienne exploserait… mais malheureusement, à ce jour, cela n’a pas encore eu lieu.
Je n’avais pas encore idée de quelle façon j’allais rejoindre l’Allemagne. Le voyage des réservistes était pris en charge par le Consulat alors que, comme le Landssturm [1] n’avait pas encore été mobilisé, nous, les engagés volontaires, nous devions tenter la traversée à nos frais. Cependant notre entreprise allemande, la « Compania Ferretera Mexicana » (Compagnie des Chemins de Fer Mexicains) vint à la rescousse et mit à la disposition des cinq employés qui voulaient rejoindre l’Allemagne l’argent nécessaire au voyage. On nous versa même le salaire du mois d’août tout entier et la possibilité nous fut donnée de mettre le gros de nos bagages à l’abri dans les locaux de la société pour la durée de la guerre. L’émotion grandissait d’heure en heure. Nous n’avions plus l’esprit à travailler pour la société. Au Cercle Allemand, il y avait des allées et venues permanentes, un flot continu de rumeurs et d’informations parcourait la colonie. Des tirages spéciaux de la Deutsche Zeitung [2] furent distribués en allemand et en espagnol pour faire pièce aux âneries que répandaient déjà les informations de l’Entente.
Le 3 août, je fus à nouveau invité à dîner par le Consul Général d’Allemagne, ce que j’acceptai, mais au moment même de quitter ma maison, je fus pris d’une crampe d’estomac qui m’obligea à revenir chez moi. Je fis venir un médecin, le Docteur Hitzig, un Suisse, qui finit par arriver alors que la crise était passée. Il me fit diverses prescriptions, m’assura que je pourrais sans problème me rendre en Europe et m’établit en même temps un certificat rédigé en anglais attestant que je ne supportais pas le climat de la région et qu’il me fallait donc rentrer en Europe. Ce document était censé m’éviter d’être fait prisonnier au cas où nous entrerions en guerre contre les Français ou même les Anglais. Malheureusement, les choses prirent une mauvaise tournure, comme nous le verrons plus loin mais par contre, ce document allait me rendre service à moi. De nombreuses entreprises allemandes avaient mis à la disposition du Consulat d’importantes sommes d’argent pour payer le voyage de ceux qui étaient sans moyens.
Le 4 août, le premier contingent de réservistes fut mis en route pour Veracruz alors que moi, je ne pus me joindre au deuxième que le lendemain. La gare était noire de monde : presque toute la colonie allemande était présente, on nous couvrit de fleurs, on nous donna des cadeaux comme si nous étions en partance pour le front. En dépit des visages radieux, on ne pouvait pas s’empêcher de ressentir une certaine émotion. Pour finir, nous chantâmes : muss i denn, muss i denn [3], les adieux n’en finissaient pas.
Lorsque le train s’ébranla lentement avec trois-quarts d’heure de retard, tous se mirent à chanter d’une voix forte et avec enthousiasme le Deutschland, Deutschland über alles [4]. Le train nous emporta alors par cette merveilleuse matinée d’automne ; après une heure de voyage, nous passions devant les pyramides mexicaines de San Juan Teotihuacan, que j’avais pu visiter peu de temps auparavant et nous arrivions avec beaucoup de retard à Veracruz vers minuit. Il nous fallut attendre quatre jours sur place avant d’avoir la possibilité de poursuivre notre route vers les Etats-Unis sur un petit caboteur norvégien. A ce moment-là, les Américains occupaient encore la ville mexicaine de Veracruz ; l’armée comptait dans ses rangs de nombreux Allemands qui auraient bien aimé se joindre à nous. On disait même que certains auraient déserté. Un vieux sergent me fit cadeau de sa photo avec une dédicace : Que Dieu bénisse les armées allemandes et leur donne la victoire. Un autre dont le père avait été allemand ajouta au dessous : never give up the ship, long life your flag [5]. Ces hommes sont peut-être aujourd’hui contraints de se battre contre leur ancienne patrie.
Le bateau ‘City of Tampico’, sur lequel on nous obligea à demeurer quatre jours, était une vieille barge d’une incroyable saleté. L’hébergement et la nourriture étaient également lamentables eu égard au prix du billet. Nous étions heureux malgré tout qu’il nous emmène à Galveston. Plus tard, au cours de notre captivité, la bonne nouvelle nous parvint que le ‘City of Tampico’ avait reçu une torpille. Sur le bateau, il y avait aussi des prêtres mexicains qui fuyaient vers les Etats-Unis pour échapper aux révolutionnaires avant leur arrivée dans la capitale. Au cours du voyage, il y avait une escale obligatoire à Tampico où le paquebot allemand ‘Antonina’ était à l’ancre et contraint d’y rester jusqu’à la fin de la guerre. L’équipage nous fit monter à bord généreusement cinq miches de pain et cinq fûts de bière. Une infirmière de la Croix Rouge qui nous accompagnait déjà depuis Mexico accepta la tâche de partager le pain de façon exacte de sorte que chacun pût en obtenir une part. Au cours de la manœuvre de l’entrée et de la sortie du port nous pouvions voir de nombreux hérons et des bancs de dauphins.
Le 10 août à 11 heures du soir, à demi-groggys de chaleur et de saleté, nous atteignons le bâtiment de douane de Texas City. Après récupération de nos bagages, nous fonçons vers Galveston à quatre dans une voiture de location, ville que grâce à Dieu nous atteignons après une heure de course à si grande vitesse que c’est pour moi aujourd’hui encore un mystère que nous soyons arrivés vivants. Notre chauffeur faisait la course avec deux autres voitures bien que la route soit mal éclairée et par ailleurs en tellement mauvais état que nous étions plus souvent en l’air au-dessus des sièges que vraiment assis. Nous restons un jour et deux nuits à Galveston et le matin du 12 août, à sept heures, nous partons en train vers New-York pour un voyage de soixante-douze heures. Nos billets étaient établis via les Chutes du Niagara mais nous ne pouvons pas effectuer ce trajet-là au risque de nous faire prendre par les Anglais sur le territoire canadien. L’une de mes premières démarches à New-York que nous atteignons le 14 août, me conduit au Consulat d’Allemagne assiégé en permanence par la foule innombrable de ceux qui, en provenance de tous les coins de l’Amérique, affluent pour, comme nous, se rendre en Allemagne.
Il nous faut attendre dix jours à New York une correspondance de paquebot, ce qui nous donne assez de temps pour visiter la ville et ses gratte-ciels tellement surprenants pour nous. Dans un premier temps, des bateaux italiens sont prêts à prendre à leur bord des réservistes allemands mais plus tard, cette offre est annulée par la compagnie de navigation et les billets délivrés sont repris. Le seul choix qui nous reste est soit de retourner à Mexico, soit de prendre le bateau ‘Nieuw Amsterdam’ de la Ligne Holland-Amerika. Nous décidons de choisir cette dernière option, étant donné le long voyage que nous avons déjà effectué. Au cours de la nuit du 24 août, vers minuit, le paquebot se met en route, salué par les acclamations d’une foule innombrable, et longe les appontements de Hoboken.
Les hymnes nationaux allemands sont entonnés et accompagnent notre sortie vers la nuit noire. Beaucoup sont restés sur place, craignant d’être interceptés pendant le voyage. Mais à cet instant-là, nous, les autres, sommes d’avis que l’on ne peut pas obliger des civils à descendre de leur bateau et les faire prisonniers, alors qu’ils se trouvent sur un bateau neutre qui va d’un pays neutre vers un pays comme la Hollande, neutre lui aussi. La traversée du port illuminé est merveilleuse ; au passage, la grande statue de la Liberté nous salue avec son flambeau éclairé et les gigantesques immeubles de New-York nous offrent un spectacle féerique dans l’obscurité.
Pendant la traversée, on organise à bord des soirées récréatives. Il y a des séances de lecture et d’agréables prestations musicales. Pourtant, nous ne pouvons pas échapper à une certaine nervosité à mesure que nous approchons du continent européen. Muni du certificat médical établi au Mexique, je me sens en sécurité. Par précaution, nous avons convenu avec l’infirmière de la Croix Rouge que nous allons faire comme si, patient et garde-malade, nous faisions le voyage ensemble. A New York déjà, nous nous sommes inscrits de cette façon dans le registre du bord et pendant la traversée, on me donne régulièrement mes gouttes à prendre après les repas. L’excitation causée par l’éventualité d’une capture par les Anglais grandit
Nous sommes faits prisonniers, le calvaire commence
et voilà que, le 2 septembre 1914, jour anniversaire de Sedan, à 5 heures du matin un coup de canon invite notre paquebot à stopper. Nous nous précipitons sur le pont et dans le soleil de l’aube, nous voyons devant nous un croiseur auxiliaire arborant le drapeau tricolore. Quelques officiers français viennent à bord ; ils sont suivis de matelots armés, baïonnette au canon, que l’on répartit dans le bâtiment. Sous la conduite d’un officier français, notre bateau est contraint de suivre le croiseur auxiliaire ‘La Savoie’ en direction de la France. Le soir, vers 11 heures, entourés de six torpilleurs et éclairés de tous côtés par des projecteurs, nous entrons dans le port de Brest.
Le lendemain, on nous informe que, avec nos bagages à main, nous devons être prêts à 5 heures de l’après-midi à quitter le navire dans le but de subir à Brest une visite médicale, ceci valant pour tous les Allemands et les Autrichiens âgés de 16 à 60 ans. Muni de mon certificat dans une main et ma garde-malade à l’autre, je fais de multiples démarches pour expliquer aux officiers français que je suis en mauvaise santé et que je ne peux en aucun cas quitter le bord. Un officier m’indique enfin que le médecin se trouve en bas sur le bateau qui doit nous conduire à terre. Dès lors que j’ai quitté le ‘Nieuw Amsterdam’, je ne peux plus revenir en arrière. L’un des derniers Allemands à descendre est un certain Dr Koch qui avant d’atteindre le bateau français lance un vivat tonitruant pour l’Empereur auquel nous nous joignons malgré les gardes médusés, armés, baïonnette au canon. Répartis dans plusieurs embarcations, on nous fait traverser le grand port de Brest jusqu’à un petit village de pêcheurs appelé Le Fret où on nous oblige à descendre et à nous regrouper par quatre. J’aide un malade qui ne parle pas français à descendre et essaye de lui trouver un transport car j’ai entendu que nous avons à effectuer plusieurs heures de marche. Il s’écoule un certain temps avant qu’une voiture arrive, si bien que je me trouve séparé de mes amis mexicains et que je dois me joindre à un groupe de Polonais. Entre temps, le malade a pu obtenir une place dans la voiture du boulanger et on nous oblige à déposer dans une grange nos bagages à main qui doivent être acheminés plus tard en voiture. Un Polonais ou un Allemand du sud qui n’a pas compris cet ordre ou qui n’a pas envie de s’y conformer car il emporte dans son sac toutes ses économies réalisées en Amérique, soit plusieurs milliers de dollars, est tué d’une balle, sans autre forme de procès et sans qu’on ait cherché à lui expliquer le problème. Les Français sont dans un tel état d’énervement face au nombre de prisonniers - nous sommes environ 800 - , qu’ils semblent perdre la raison. Ensuite, la nuit tombe et nous traversons en marche forcée le village de Crozon pour rejoindre la citadelle qui porte le même nom. Bien sûr nous sommes l’objet d’une surveillance extrême. Un monsieur d’un certain âge qui ne peut pas supporter cette marche forcée s’effondre ; un des gardes essaye à coups de pieds et de crosse de l’obliger à poursuivre la marche, en vain bien évidemment. Quelques-uns d’entre nous qui veulent l’aider sont renvoyés dans le rang sous la menace des baïonnettes.
À FORT CROZON
La nuit tombée, on nous fait entrer dans la forteresse, dans des casemates voûtées, à 60 par pièce, non sans avoir été fouillés minutieusement, à la recherche d’épingles, allumettes, couteaux ou ciseaux. Le local, qui ressemble fort à un cachot prévu pour de grands criminels, est éclairé par un petit bougeoir et contient 9 lits à 2 étages avec en guise de matelas des planches en bois. Dans un angle, nous trouvons un petit tas de paille, insuffisant et de beaucoup, pour satisfaire tout le monde. Il ne faut pas penser à se déshabiller car nous n’avons ni notre linge de nuit, ni la moindre couverture. Plus tard, on nous apporte du pain et de l’eau et après cela, on nous laisse seuls, notre première nuit de captivité commence.
L’impression d’être prisonniers n’est vraiment ressentie qu’à ce moment-là, lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes et séparés de tous ceux que nous connaissons. Il va falloir végéter dans un lieu comme celui-là pendant des semaines, voire des mois, sans que la fin soit prévisible ; nous sommes harcelés par cette idée. A cela s’ajoutent l’écœurante habitude des Polaques de cracher, la puanteur de la paille humide des bât-flancs et enfin la situation sanitaire liée aux besoins du cycle digestif, tout cela est proprement horrible. Pour satisfaire ses besoins, il y a dans la pièce un seau sans couvercle, utilisé pendant la nuit de façon ininterrompue. Il est facile d’imaginer l’air de la pièce, il empeste tellement que certains de nos camarades préfèrent passer la nuit sur les dalles de pierre, à l’entrée, près de la fenêtre grillagée de rails de chemin de fer, plutôt qu’à proximité de ce seau.
Par la suite, on nous donne régulièrement de l’eau le matin entre 9 et 11 heures, le midi une soupe claire avec des haricots, du riz ou équivalents et du pain, le soir à 7 heures des pommes de terre avec de petits morceaux de viande et du pain. Une sortie d’une demi-heure par jour nous est accordée dans un fossé profond qui fait partie de la forteresse de Crozon, évidemment sous bonne garde. Après la promenade, nous avons la possibilité de nous laver à une pompe, ce que pourtant nous évitons de faire autant que possible car l’eau est constamment sale et a mauvaise odeur. Le reste de la journée, nous sommes bien obligés de le passer dans la casemate à faire des allers-retours de quinze pas dans la pièce en ruminant la question de savoir quand tout cela va s’arrêter. Nous sommes évidemment totalement coupés du monde extérieur. Si des journaux ou autres sont découverts, nous risquons la peine de mort. Un peu plus tard a été installée en bas dans la cour une cantine où, à des prix inouïs, on nous vend du chocolat, du vin rouge et même du lait, etc… En fait, ce n’est pas que les prix soient tellement élevés, mais un escroc de changeur profite de la situation pour nous échanger notre argent allemand ou américain à des cours usuraires. Et il nous faut bien changer de l’argent pour mettre un peu de variété dans notre gamelle de prisonnier.
Après la première semaine qui nous sembla durer une éternité, on devait nous accorder l’autorisation d’envoyer du courrier en Allemagne. Mais cette autorisation fut annulée pour notre chambrée car, dans la couchette d’un camarade, avait été trouvée une pierre laissant penser que le prisonnier avait voulu faire de sa cuillère, seul élément de couvert que nous possédions, une lame de couteau. Toute la chambrée fut privée de sortie pendant une semaine et le coupable eut 15 jours d’arrêt de rigueur. La sensation éprouvée à rester huit jours enfermés dans un local comme celui-là sans sortir à l’air libre ne peut être vraiment comprise que par quelqu’un qui a connu le début de cette captivité. Donc pas de cantine, pas de toilette et pas de courrier. Mes compagnons de cellule ne parlant pas français, il me fallait jouer les traducteurs, tâche ingrate car il était quelquefois bien difficile de retransmettre en français à nos gardiens les souhaits des Polaques qui, le plus souvent, ne parlaient pas allemand et qui, à part dans leur langue maternelle ne pouvaient se faire comprendre que grâce à quelques mots d’anglais. Ce n’est que dans ce genre de circonstances que l’on apprend à apprécier à sa juste valeur l’apprentissage des langues étrangères et que, plus tard, on est souvent reconnaissant aux professeurs pour le mal qu’ils se sont donné pour vous les enseigner.
De façon régulière avaient lieu des fouilles au corps et des inspections de chambrées, mon journal y a toujours échappé. S’il avait été possible de déterminer combien de temps nous allions endurer cette vie, il aurait été plus facile de supporter tout cela, mais cette incertitude et notre ennui étaient un supplice. Il reste que, avec le temps, nous devenions inventifs. A l’aide d’un vieux crayon-encreur, nous tracions un damier sur des mouchoirs blancs et jouions aux dames avec des pièces de cuivre et de nickel ; un codétenu très doué réalisa avec de la pâte à pain qu’il avait mise de côté petit à petit des pièces d’échec en s’aidant d’un cure-ongles.
Malgré tout, la situation devient insupportable. Tous les jours du pain et de l’eau et des haricots ou du riz en quantité insuffisante. La question du seau elle non plus n’a pas de solution malgré nos demandes répétées. Depuis que nous avons quitté le bateau, nous n’avons pas revu nos bagages à mains et donc nous sommes vraiment crasseux. Mais nos gardiens qui eux pourtant ont la possibilité de se laver, n’ont pas meilleure allure que nous : les Français ont une conception surprenante de la propreté. Les nuits commencent à être vraiment froides pour nous qui venons des tropiques ; certains camarades tournent en rond dans la chambrée la nuit pour se réchauffer car nous n’avons toujours pas de couvertures. De simples planches, un peu de paille dessus, la veste pliée sur les bottes en guise d’oreiller, c’est tout ; et en plus, la terrible incertitude sur la durée de notre captivité. Quelqu’un a tracé un calendrier sur le mur, si bien que nous pouvons connaître la date du jour. Nous faisons des paris quant à la durée de la guerre et de petites diversions de ce genre nous aident à passer les heures interminables de la journée.
Une crampe d’estomac me fait consulter le médecin qui rédige une ordonnance pour un bon de lait et juge nécessaire de me parler de la guerre. Il dit que les Allemands n’auraient pas dû mitrailler la ville de Louvain (Belgique) comme ils l’ont fait et que, dans cette action, ils avaient tué des femmes. A ma remarque que cela ne se serait sûrement pas produit si les Belges avaient déclaré leur ville ouverte sans faire d’histoires et si ces femmes elles-mêmes n’avaient pas participé à la fusillade contre nos troupes, comme nous l’avions appris à New-York, il répond qu’il avait toujours cru que les Allemands avaient un niveau de civilisation équivalent à celui des Français. Par contre, il n’est pas possible de lui ôter l’idée de la tête que les Français prisonniers des Allemands sont plus malheureux que nous ici. Si j’avais eu plus de temps pour discuter, je lui aurais carrément apporté la preuve que cela était tout simplement impossible.
Au-delà des maladies vénériennes, il y a parmi nous des camarades infestés de poux et de punaises, dans une autre chambrée la gale s’est déclarée. Et la lancinante question permanente : combien de temps encore ? C’est ici vraiment le bon endroit pour étudier le genre humain quand des hommes de tous les coins du monde sont rassemblés comme nous ici qui venons du Mexique, du Pérou, du Guatemala, d’Haïti, d’Argentine et de tous les coins des Etats-Unis d’Amérique, tous réunis par le désir d’aller en Allemagne et de participer. Les plus nombreux sont les commerçants, mais il y a aussi des acteurs, des tailleurs, des artistes, des cochers, des étudiants, des garçons de café, des ingénieurs, des bouchers, etc…
SUR LE ‘CHARLES MARTEL’
Dans l’après-midi du 22 septembre, on nous avise que nous devons nous tenir prêts à être transférés à Brest le lendemain matin. Ceci provoque beaucoup d’excitation et bien évidemment, les bruits et les avis les plus divers se mettent à circuler. Certains pensent que nous allons au Maroc, d’autres croient à un échange contre des civils français, prisonniers en Allemagne. Tous échangent leurs adresses pour le cas où nous serions séparés. Il règne une ambiance comme si nous allions directement en Allemagne pour être échangés car malgré notre grande excitation, la plupart d’entre nous pensent que notre sort ne peut pas être pire.
Le lendemain matin, il nous faut nous ranger par quatre en bas dans la cour après avoir à nouveau balayé notre carrée et été revigorés avec du pain et de la soupe à l’eau. La gamelle sous le bras et la cuillère à la main, nous partons tous et quittons Crozon le cœur léger. Dans le village, la population nous fait la haie sans nous importuner si ce n’est que quelques vieilles femmes nous menacent du poing. Après avoir marché une heure dans un joli paysage vallonné, nous arrivons au petit village du Fret. On nous fait monter dans des barcasses pour traverser le port et nous ramener à l’endroit où avait mouillé le ‘Nieuw Amsterdam’ et où maintenant se trouve l’ancien croiseur ‘Charles Martel’ désarmé. Ce dernier doit nous servir d’abri sept semaines durant. Nous ne soupçonnons évidemment pas que notre séjour ici va durer sept semaines, nous sommes ici par contre encore dans la terrible incertitude de ce que l’on va faire de nous et de combien de temps encore durera notre captivité. Quoi qu’il en soit, sur le vieux croiseur, nous nous sentons nettement mieux qu’à Fort Crozon. En effet, ici, nous pouvons passer presque toute la journée en haut sur le pont, exposés au soleil d’octobre encore chaud et passer notre temps à courir et à nous attraper. En cas de pluie et ensuite par temps froid en novembre, nous sommes limités aux espaces situés sous le pont et nous nous sentons très à l’étroit. Il reste que la nourriture est plus copieuse et que nous recevons les premières lettres et les premiers colis de chez nous. Ce qui est le plus pénible, c’est le manque total d’eau douce. Tous les jours, un bateau vient de Brest nous livrer l’eau douce dont nous avons besoin ; nous devons, à tour de rôle, actionner la pompe pour charger sur notre bateau l’eau, qui le lendemain, nous permettra de nous laver et de préparer nos repas. Étant donnée la pénurie d’eau, il faut être très économe. L’eau est transvasée dans de grands bassins et chaque groupe, car nous sommes toujours organisés en groupes comme à Crozon, chaque groupe donc dispose d’un bassin pour les ablutions. Si le matin, on n’arrive pas à temps sur le pont, on est obligé de se laver dans l’eau avec laquelle 59 hommes se sont déjà lavé le visage et les mains. Après que chacun a pu faire cette toilette-là, on peut, dans la même eau, laver ses sous-vêtements, puis alors seulement se laver les pieds et la partie inférieure du corps. Pour finir, cette eau sert encore à nettoyer le pont.
On voit qu’en France le rationnement commence dès fin 1914 même si au départ cela ne concerne que l’eau !!! De plus, on nous oblige à décharger le charbon ou les provisions qui nous sont destinés et à assurer le nettoyage du bateau.
Fin septembre apparaissent les premiers soldats allemands blessés. Ils viennent de l’hôpital de Brest pour passer avec nous la suite de leur convalescence. C’est un grand bonheur pour nous d’avoir des compatriotes avec nous. Avides de savoir, nous n’arrêtons pas de les harceler de questions ; nous voulons savoir, nous revendiquons de savoir comment vont les choses dans notre pays qu’il ne nous est pas permis de rejoindre. Les soldats allemands ont subi de graves blessures, certains souffrent beaucoup, ils ont tellement la fièvre que nous nous faisons un devoir charitable de partager avec eux les colis que nous avons reçus de chez nous. Ensuite, six semaines plus tard, enfin, nous pouvons récupérer nos bagages, nous pouvons donc fournir un minimum à ces pauvres blessés qu’on nous a envoyés sans linge de rechange. Par la suite, il en vient d’autres, si bien que progressivement les récits des malades nous permettent de nous faire une idée des horreurs de la guerre et aussi d’entendre parler de nos grands combats victorieux.
Mais les descriptions les plus captivantes et les récits les plus intéressants se tarissent, l’ennui recommence à nous ronger et ne permet plus de refouler l’angoissante question : combien de temps nous faudra-t-il encore patienter ? Tous les livres dénichés auprès des amis ont été lus et relus. On fait des patiences jusqu’à l’étourdissement et toujours cette terrible incertitude.
Installation à l’Île Longue. Notre situation s’améliore.
Notre transfert à l’Île Longue nous arrache à ces idées noires obsédantes. C’est une petite presqu’île proche de Crozon qui s’avance dans le port. Les bruits les plus décourageants précèdent notre arrivée : nous devrons commencer par construire nous-même le camp, il n’y a pas d’eau sur place ni non plus de possibilité de se chauffer en hiver et bien d’autres choses encore. Finalement, c’est à peu près la situation que nous allons trouver, bien souvent même nos pires craintes seront-elles dépassées par la réalité. Cependant l’humour grinçant propre à la jeunesse permet de voir tout cela de façon beaucoup moins sombre que c’est dans la réalité. Nous sommes contents d’aller et venir dans le camp maintenant, de faire semblant d’être prêts, comme le souhaite le gouvernement français, à suer sang et eau pour construire nos baraquements et les chemins alors qu’au fond cette occupation nous permet de conserver notre bonne humeur et notre humour. Plus difficile est la situation de ceux qui n’ont ni famille proche ni cousins pour envoyer de temps à autre un colis ou de l’argent et qui pour cette raison dépendent de la générosité des autres camarades.
Cependant, au fil du temps, la vie s’organise comme dans un petit village, certains sont prêts à faire la lessive des autres pour de l’argent, à nettoyer vêtements et autres ou à repriser les chaussettes, à vous remplacer si vous n’avez pas envie de faire quelque travail commandé, etc... Depuis que les Français commencent à comprendre que nous ne sommes pas des vrais barbares, ce qui se dit encore de nous dans les journaux français, et depuis que l’opinion est convaincue que les Français sont bien traités en Allemagne, on nous accorde progressivement un peu plus d’autonomie. Bien sûr, nous n’avons pas l’autorisation de quitter le camp mais l’organisation interne du camp est presque exclusivement du ressort des Allemands.
Ce sont surtout les nombreuses [menaces de] [NDT] représailles allemandes qui expliquent ces faveurs, ces représailles [menaces, NDT] ayant été rendues nécessaires au vu des traitements horribles auxquels avaient été soumis nos compatriotes en Afrique.
Il faut une année entière (= fin 1915) pour que nous obtenions enfin l’autorisation de créer un terrain de sports. Depuis, nous jouons beaucoup au football, au hockey et même aux quilles et au tennis. Le dimanche, l’orchestre du camp donne des séances récréatives l’après-midi et l’association de la chorale des Allemands de l’Île Longue offre de très beaux concerts. Depuis peu, nous avons même un théâtre où, avec goût et sérieux, vont être données par un comédien professionnel des pièces comme « die Räuber », « die versunkene Glocke », « der Pfarrer von Kirchfeld », et d’autres encore. Pourtant, malgré toutes ces possibilités de se distraire, il y a toujours la clôture de barbelés, la captivité. La lecture des journaux français est autorisée, celle des journaux allemands strictement interdite. En fait, cette interdiction n’empêche pas que, le jeudi, à la distribution des colis, nous faisons passer en cachette les journaux allemands les plus récents et que grâce à cela, nous pouvons fêter ensemble toutes les victoires remportées par nos soldats.
Pour l’animation intellectuelle, quelques camarades ont fondé un journal du camp appelé « die Insel-Woche », [6]. Ce journal, distribué tous les dimanches matins et reproduit sur un hectographe a pu exister pendant plusieurs semaines sans que le commandement du camp le sache. C’est par hasard que la chose s’est ébruitée et il a alors été rendu obligatoire de déposer un exemplaire sur le bureau du commandant pour la censure. En plus de ce qui s’est passé dans la semaine au camp, l’Hebdo de l’Île parle du front, publie des articles scientifiques et même de jolis dessins et de beaux poèmes. C’est ainsi que, par exemple, la couverture du numéro de Noël 1915 portait le poème suivant :
Les routes sont brillantes, les bois sous la neige,
Ton pays te salue dans son habit de Noël
Tous ceux qui t’aiment, retournés
à leur solitude, pensent à toi,
Tu es dans leurs pensées fidèles,
Pour toi, ils ont donné à Noël encore un air de fête.
En pensée si souvent déjà
Ils ont souhaité tellement pour toi la liberté.
Ne laisse pas gâter la magie du sapin de Noël
Pense à ceux qui te sont chers, ils pensent à toi.
En plus, dans le journal on annonce les résultats des compétitions, on publie le programme des concerts. Dans le numéro 30 (23 janvier 1916) paraît un article sous le titre :
L’hygiène est-elle le fondement de la civilisation ? qui traite de la mauvaise qualité du pain qui nous a été servi pendant une période.
L’auteur y écrit entre autres :
« Tout Allemand à l’étranger, qu’il y soit de son plein gré ou non, est fier des résultats obtenus par l’Empire allemand pour ses exportations de matériel pédagogique. Ces messieurs de Brest chargés de cuire notre pain semblent avoir bien du mal à prendre leur tâche au sérieux. Nous en voyons la preuve dans certains cas récents qui se font de plus en plus nombreux. Par exemple, on trouve dans le pain de la ficelle, des queues de souris, des cafards, des souris tout entières et dernièrement même les restes de légumineuses digérées par un cheval, ce qu’on appelle d’une façon habituelle crottin de cheval. Ces cas sont prouvés de façon irréfutable, ils restent inacceptables. Le prisonnier qui est bien obligé de se contenter de ce pain, considère cela comme le signe patent du peu de cas que l’on fait de personnes sans défense. La presse française ne tarit pas d’éloges sur la civilisation atteinte par sa glorieuse nation. Mais il me semble que les lecteurs de cette presse ont quelque peine à saisir le sens des grands discours. L’un des premiers fondements de la vraie civilisation, c’est l’hygiène. Est-ce qu’on peut défendre un idéal de civilisation par la parole ou encore par les armes, si l‘on est hésitant en matière d’hygiène ? » Etc…
Suite à cet article, le journal du camp, seul de ce genre en France, fut interdit, de même tout concert et pièce de théâtre. L’auteur de l’article fut puni de trente jours d’arrêt de rigueur,… cependant la qualité du pain s’améliora.
Enfin la liberté, mais par étapes
Fin 1915, dans les journaux français et allemands, commencent à circuler des rumeurs concernant d’éventuels échanges de prisonniers via la Suisse. Dans un premier temps, on croit préférable de ne pas accorder de valeur à ces rumeurs, mais ensuite la question revient dans les conversations et finalement, on s’accroche à cet espoir, comme une personne qui se noie à un fétu de paille. Soudainement, une grande partie d’entre nous tombe malade, on se souvient de maladies qu’on a depuis longtemps oubliées et on cherche quelles maladies on pourrait bien invoquer. Notre patience est encore cette fois mise à rude épreuve, plus de quatre mois passent avant que la perspective de la venue d’une commission médicale suisse semble se rapprocher. Comme les dix-huit premiers mois de notre captivité, les jours qui précèdent l’arrivée des médecins suisses finissent par s’écouler et effectivement, le 6 avril 1916 a lieu le grand examen médical pour ceux qui s’étaient déclarés malades. Presque tous tentent leur chance, alors pourquoi pas moi avec mon certificat établi à Mexico ? Ça ne peut pas être préjudiciable, donc j’y vais. Je suis l’un des derniers à subir l’examen et … suis classé bon pour la Suisse. Il n’y a pas de mots pour dire la joie que j’éprouve de sortir de ce camp entouré de barbelés et d’être enfin traité à nouveau comme un homme. Le dimanche de Pâques 23 avril 1916, nous quittons l’Île Longue, très enviés par les camarades qui restent. Nous sommes bloqués à Lyon, à la frontière suisse, pendant quatre jours pour un nouvel examen médical. Parmi les 200 hommes qui avaient été désignés pour aller en Suisse, 60 sont renvoyés à l’Île Longue et nous sommes vraiment navrés de devoir prendre congé de ces malheureux.
Le 1er mai (1916), nous quittons Lyon et arrivons à Genève le soir à 11 heures. Dans le train, les accompagnants sont déjà des membres de la Croix Rouge suisse ; cependant nous avons l’impression qu’il faut attendre d’avoir passé la frontière pour nous réjouir vraiment et c’est ce que nous faisons. Après la frontière éclatent des cris de joie indescriptibles auxquels répondent les cris de joie des écoliers suisses. C’est un débordement de joie et de bonheur comme j’en ai rarement vécu. Nous sommes enfin délivrés de l’ennemi et en terrain neutre, pas de clôture de barbelés ni de baïonnettes. Notre traversée de la Suisse prend l’allure d’une marche triomphale. A Genève, on nous couvre de fleurs, on nous donne des provisions. A chaque gare, on nous accueille en chansons, avec des fleurs et des cadeaux. A Berne, nous croisons un train de prisonniers français en provenance d’Allemagne, ils ne semblent pas moins heureux que nous. Nous sommes répartis dans divers cantons suisses et c’est la raison pour laquelle il nous faut nous séparer de nombreux camarades pour poursuivre notre voyage. Le 2 mai vers 11 heures, nous atteignons Saint-Gall où à nouveau on nous a préparé un superbe accueil. On nous ravitaille et par un chemin de fer de montagne, nous montons dans l’alpe de Appenzell où, en cette saison, les arbres fruitiers sont en pleine floraison. Ce voyage restera toujours dans ma mémoire. Sur tout le parcours, depuis les maisons, on nous fait des signes de la main ; dans les petites gares, des enfants approchent du train avec des corbeilles de fleurs et des cadeaux pour nous être agréables. A Teufen, notre gare de destination, une équipe de secouristes suisses et les enfants de l’école nous conduisent au sanatorium de Bad Sonder où nous devons nous remettre de la captivité. Après avoir passé là un vraiment bel été au cours duquel nous avons la possibilité de parcourir les belles montagnes de l’Alpstein, je me fais inscrire à la société allemande de secouristes de Saint-Gall qui m’embauche dans le service d’assistance aux survivants et aux invalides.
Pendant une année je peux être au service des victimes de la guerre mais pour les seules familles et invalides qui résidaient en Suisse avant la guerre et n’avaient pas renoncé à la nationalité allemande. Fin septembre 1917, je suis l’un des privilégiés à pouvoir, pour raison de santé, être échangé et retourner chez moi. Je ne veux pas croire à mon bonheur mais le 22 septembre, nous passons la frontière et entrons en Allemagne. Après un bref séjour à Constance, on nous laisse rentrer chez nous. Les vacances tellement désirées après 4 ans d’éloignement de la maison refoulent dans l’inconscient tout ce que je viens de vivre, au point même que j’oublierais presque mes pauvres camarades encore en captivité. J’ai certes des échanges épistolaires avec eux mais je reprends conscience de leur triste situation grâce à un article de la Inselwoche qui vient de reparaître. Cet article s’adresse aux représentants neutres de la Croix Rouge Internationale qui viennent de se concerter sur le sort des prisonniers ; c’est un appel au secours des prisonniers, enfermés depuis le début de la guerre derrière les barbelés, épuisés physiquement et moralement par les années de captivité.
« Comme il est amer de constater, dit l’auteur de l’article, que pendant des années, nos autorités elles-mêmes n’ont rien fait pour nous les prisonniers civils, si ce n’est pour de rares groupes. La Croix Rouge elle même admet s’intéresser dans une moindre mesure aux prisonniers civils allemands ; comment sinon se ferait-il que, selon l’aveu de la dernière commission en Suisse, une large part des collectes populaires effectuées en Allemagne pour les prisonniers de guerre, aille aux camps militaires et par contre quasiment rien aux prisonniers civils. Certes, nous sommes fiers d’avoir réussi à trouver jusqu’à maintenant dans le camp lui-même les moyens d’atténuer la misère des prisonniers, pourtant nous sommes au bout de nos forces, parfois aussi au bout de notre volonté de lutter.
Donc, si ces jours-ci, au siège de la Croix Rouge à Genève, les délégués danois, hollandais, norvégiens, suédois et espagnols du CICR se concertent sur la situation des prisonniers de guerre et sur les moyens à mettre en œuvre pour les soulager avant l’hiver qui approche, nous voudrions rappeler de façon pressante à ces messieurs de ne pas oublier non plus les prisonniers civils, internés le plus souvent au cours des premiers mois de la guerre en 1914. Mettez-nous où bon vous semble, mais sortez-nous des camps entourés de barbelés. Nous savons que la situation actuelle dans le monde n’est pas reluisante. Nous ne demandons pas de vivre dans l’abondance et les plaisirs, nous voulons seulement retrouver enfin notre liberté et notre travail. Si les souffrances innombrables de la guerre mondiale ont émoussé chez vous le sentiment de compassion, nous ne voulons pas de votre pitié. Nous avons le droit d’être libres, nous qui avons été faits prisonniers alors que nous n’avions pas les armes à la main. Nous en appelons à votre sens du droit. Et si les gouvernements en guerre, confrontés à tous les autres soucis de l’heure, ne peuvent pas se mettre d’accord à notre sujet, nous, les prisonniers civils, nous attendons de vous, les neutres de Genève, que réunit l’insigne de la Croix Rouge, que vous trouviez un accord à notre sujet et que vous nous rendiez la liberté. »
Mesdames et messieurs, imaginez-nous, après trois années de triste captivité, à la merci d’une puissance étrangère, sans le droit de dire un mot, parqués dans un enclos entouré de barbelés, sans perspective de libération prochaine, alors vous comprendrez l’appel qui nous parvient depuis le pays ennemi et auquel nous devrions accorder plus d’attention. Espérons que les négociations dont parlait ces jours-ci la Frankfurter Zeitung et qui se déroulent en Suisse entre la France et l’Allemagne permettront de rapatrier en Allemagne beaucoup de nos compatriotes.
Pensons aux jeunes que la captivité prive des plus belles années de leur vie. C’est ce que dit déjà Eichendorff dans le joli poème que lira tout à l’heure Monsieur Knippenberg :
« Quiconque qui veut courir le monde, doit emmener sa mie »
C’est aussi la complainte de Heinrich Führer, prisonnier dans un camp à Montauban, dans son poème :
« Comme l’abeille »
Une abeille, privée de toute volonté, inconsciente
Le parfum des roses rouges avait enivrée.
Et même lorsque je la vins déranger, l’écartai de la fleur,
la posai sur le sol, d’un coup d’aile y retourna !
Buvant ainsi tes baisers à tes lèvres rouges comme roses,
je me laisserai enivrer de plaisir et de bonheur.
Regardant au fond de tes yeux, enchanté par ta séduction,
nageant dans le bonheur en écoutant tes mots d’amour.
Nous ne devons pas non plus oublier tous les pères de famille éloignés des leurs depuis si longtemps. Les pensées qui les lient à leur village sont exprimés de façon saisissante dans le poème intitulé Sehnsucht, [7] écrit par un prisonnier au sud de la France :
Tous les matins, mon fils, lorsque se lève le soleil
Et tous les soirs quand, fatigué, il se cache
Mon âme est en quête de toi...
Où que tu sois, mes pensées sont sur toi,
toutes mes pensées, bonnes et pures,
voudraient t’apporter des bienfaits.
Et mes pauvres mains n’ont, jour après jour,
Qu’une seule envie : serrer ta tête blonde.
Dans ces deux poèmes est exprimé le désir d’être enfin délivré de cette captivité contre nature. Aidons les prisonniers que nous connaissons personnellement, soulageons leur douleur de l’éloignement par des lettres et des attentions et nous pourrons être sûrs de leur reconnaissance.
En guise d’exemple, voici un petit poème de Burmester, prisonnier au camp de La Mure :
Si, après de dures épreuves,
J’ai la chance de rentrer
Jamais femmes généreuses
Je ne vous oublierai
Pour tout l’amour dont vous avez été capables
Dans cette période
Je rendrai la pareille à
Celle à qui je donnerai mon cœur
Je termine mais ne veux pas oublier de vous remercier de votre amicale présence, de dire également merci aux artistes qui ont accepté d’agrémenter cette soirée, sans omettre ceux qui ont eu la bonté de prendre en charge l’ensemble des coûts engendrés par notre réunion. La recette intégrale pourra donc être versée à l’association allemande d’entraide de l’Île Longue au profit des camarades nécessiteux.