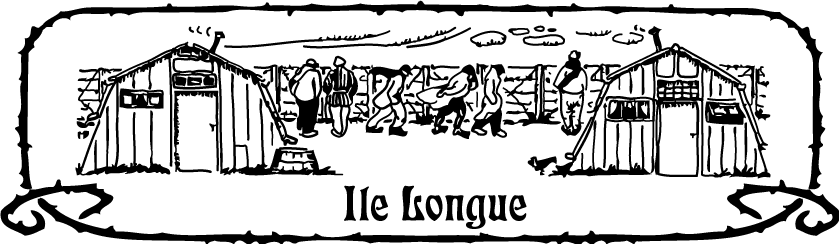« Les mémoires de Rudi » – Chronique des fils de Rudolf Hoppe
Traduction de l’allemand par Annie Hebel-Kérinec
Dieter Hoppe complète le témoignage de son frère Rudi en relatant ici l’histoire de son père Rudolf Hoppe.
Rudolf Hoppe a été mobilisé immédiatement à la déclaration de guerre. Il était sergent et fut blessé en septembre 1914 pendant la bataille de la Marne. Fait prisonnier il fut amené dans un hôpital militaire de campagne. Ses connaissances du français lui sauvèrent la vie car il put s’exprimer face au médecin à qui il refusa catégoriquement que ses plaies soient soignées avec des instruments non désinfectés. Soigné par une infirmière française, il fut le seul survivant des blessés de sa chambrée.
« Notre père arriva dans le camp des prisonniers de guerre à l’Ile Longue près de Brest. A l’origine ce camp fut créé en 1914 pour les internés civils qui furent cependant traités comme des prisonniers de guerre. D’autres prisonniers de guerre arrivèrent aussi en même temps. Parmi eux il y avait des détenus de l’ancienne colonie du Togo que les Anglais avaient livrés aux Français. L’un d’entre eux a très bien relaté par son récit, les affres de la détention infligée par les Français (voir Carl W.H. Doetsch, Kamina et le sort des prisonniers du Togo, Telefunken-Zeitung Nr. 19, février 1920, page 29-41).
Les internés civils (400 Allemands et 250 Austro- Hongrois) provenaient du « Nieuw- Amsterdam », paquebot à vapeur hollandais neutre. Ceux-ci voulaient rejoindre l‘Allemagne à la déclaration de guerre. On leur assura qu’ils ne risquaient rien à bord du bateau et qu’ils pouvaient embarquer en toute tranquillité, la Hollande étant neutre. Le vapeur fut capturé dans la Manche par un navire de guerre français et le capitaine de celui-ci ordonna au capitaine hollandais la reddition des passagers. Le capitaine hollandais se soumit. Pendant la capture des prisonniers il y eu énormément de blessés parmi les civils. En 1940 on devait bien se souvenir en Allemagne du comportement du capitaine hollandais qui n’avait pas su conserver sa neutralité.
Un évènement semblable se produisit un an plus tard. Un paquebot italien, nation encore neutre à l’époque, transportait des Allemands, des Autrichiens et des Hongrois qui voulaient rejoindre leur patrie en passant par l’Italie. Un navire de guerre anglais essaya de stopper les Italiens et le capitaine anglais ordonna la capture des passagers. Les Italiens refusèrent de se soumettre et signalèrent au navire anglais : « Avant de capturer mes passagers il faudra d’abord envoyer mon bateau par le fond. » Les passagers allemands et austro-hongrois purent rejoindre sans dommage l’Italie et débarquèrent à Livourne et purent rejoindre leurs patries. De ce fait aussi on se souvenait en Allemagne en 1940.
Notre père fut nommé « chef de groupe » par les prisonniers et, en sa qualité, il n’eut pas toujours à dresser des lauriers à l’administration française du camp. Un jour il fut témoin de la façon dont un officier français donna un coup de pied dans les béquilles d’un interné invalide car celui-ci n’avait pas salué comme le veut le règlement militaire. Cet homme avait été blessé si gravement lors de la capture du paquebot hollandais qu’il avait fallu lui amputer les deux jambes. L’homme dévala les escaliers. Notre père envoya l’officier valser d’un coup de poing dans le menton et celui-ci furieux, sortit son révolver : « pour cela je peux vous descendre tout de suite », cria-t-il. Notre père répondit calmement : « Vous pouvez le faire, mais dans les minutes qui suivent vous êtes un homme mort ». Les prisonniers s’étaient rapprochés du groupe en prenant une attitude menaçante. L’homme trembla. Les gardes français restèrent sans réaction à côté, appuyés à leurs fusils en ricanant. De toute évidence, leur officier du type guerrier patriotique et grognon, comme on le trouve dans toutes les armées, leur était aussi antipathique. Ils ne bougèrent pas, c’est à dire qu’ils ne firent même pas l’effort de lever leurs fusils et faire face à la menace des prisonniers. Ces soldats du planton avaient été faits prisonniers de guerre en Allemagne et du fait de leur mauvais état de santé ils avaient été échangés par la Croix-Rouge suisse à condition qu’ils ne prennent plus part à aucune action guerrière. Mon père entretenait de bonnes relations avec eux contrairement au reste des gardiens. Pour son emportement contre la brutalité de l’officier contre un homme invalide et sans défense, il fut condamné encore une fois au cachot.
Les relations qu’avait mon père avec les pêcheurs bretons étaient bonnes. Il leur demanda une fois : « pourquoi n’êtes-vous pas méchants avec nous comme le sont le reste des Français ? » Ils répondirent : « nous sommes Bretons et n’avons rien contre vous ». Un des pêcheurs aurait même bien aimé avoir notre père comme gendre à la fin de la guerre. Ce même pêcheur approcha discrètement mon père plusieurs fois pour savoir si par hasard il ne pouvait pas lui procurer une pioche. Notre père put la lui procurer en passant inaperçu. Ce fut un coup dur pour notre père lorsqu’il apprit par la Croix-Rouge que sa femme aimée par-dessus tout était morte en couches. Il demanda un congé sur parole qui aurait été tout à fait possible d’après l’article 10 de la Conférence de la Paix de la Haye. La demande fut bien sûr rejetée. Par la suite il s’enfuit deux fois du camp. C’était plus difficile que ce que l’on peut s’imaginer maintenant. Il ne fallait pas qu’il essaie de se procurer des vêtements civils : s’il avait été arrêté, il aurait été pris pour un espion et fusillé sur le champ.
Il porta l’uniforme et réussit ainsi à traverser la France jusqu’au Jura, juste avant la frontière suisse.
D’après la Conférence de la Haye de 1907 et la Convention de Genève de 1906, les prisonniers de guerre devaient être traités humainement et avaient le droit d’être nourris, logés et habillés, tout comme l’étaient les troupes du pays qui les avaient fait prisonniers. On leur avait également attribué le droit, si la possibilité de s’enfuir se présentait, de le faire, afin de rejoindre leurs propres lignes. Il était spécifié que les prisonniers ne devaient pas être entravés et ne devaient pas subir de comportement arbitraire de la part de quiconque. Lorsqu’il fut fait à nouveau prisonnier, notre père eut les mains ligotées, fut traîné avec une corde et montré en revue, à la merci de la population. Les protestations et remarques de notre père mentionnant les décrets relatifs aux Droits de l’Homme n’y firent rien. De retour dans le camp il fut naturellement remis au cachot. En tant que “chef de groupe” l’administration française du camp ne lui retira pas sa fonction, même si elle ne fut pas avare en continuelles et dures “mesures disciplinaires” le concernant.
Mes parents s’établirent à Warstein, la ville natale de ma mère après leur fuite d’Allemagne de l‘Est en 1958. Là, ils prirent activement part au jumelage naissant avec la ville de Saint-Pol [ndlr : Warstein est jumelée avec St-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), depuis 1964]. Les avis étaient loin d’être unanimes des deux côtés. On trouvait dans chaque camp des adversaires au jumelage. L’ancien chef de la Résistance de St-Pol pendant la guerre,- que je connais uniquement sous le nom de Ferdinand,- refusa catégoriquement le jumelage. Cependant, il vint tout de même avec la délégation française à Warstein. Allemands et Français se retrouvèrent là, d’abord embarrassés et pratiquement muets. Pendant la guerre de nombreux Allemands avaient été soldats et avaient été stationnés maintes fois en France.
Les souvenirs de certains participants allemands à la guerre remontèrent à la surface : « c’étaient des crimes de guerre (français). Lui et aussi eux auraient dû se retrouver devant un tribunal de guerre ». (Il était sous-entendu que ces crimes de guerre avaient été commis non seulement pendant la deuxième mais aussi pendant la première guerre mondiale). Mon père dut faire l’interprète. Mon cœur s’arrêta presque de battre. Ils parlèrent vraiment en toute franchise, sans haine, sans se mentir. Ils débattirent sur la passé de façon nette et franche, comme les politiciens et journalistes le firent et le font encore.
Rien ne fut oublié. Et si je me souviens bien, on n’en reparla plus après.
« Maintenant tout est raté pour le jumelage » pensais-je. Mais l’inverse se produisit. Les Français approuvèrent de la tête. “Oui, c’était comme ça autrefois”.
Cela allait être le début de fêtes et d’amitiés durables, les échanges allaient se multiplier entre la famille et Ferdinand. Une délégation venant de St-Pol assista aux funérailles de Dieter Hoppe en juillet 1988. Ferdinand en fit partie également.
Encore une remarque. Lorsque notre père fut libéré du camp de prisonniers au milieu des années 1920 – le camp de l’Ile Longue avait été fermé officiellement en 1919 – il ne savait pratiquement rien de l’état de l’Allemagne, seulement que l’empereur avait abdiqué. Il retourna à son dernier domicile, à Halle. Il n’avait pas encore vu son fils.
Il retourna dans un pays déchiré. Après la défaite de l’Empire allemand et de l’Empire austro-hongrois la paix n’allait pas revenir dans le monde. Les puissances victorieuses maintinrent l’état de désaccord et créèrent les conditions favorables à de nouvelles luttes.
La lutte en Allemagne allait prendre une grande ampleur. Ce serait la légitimation d’un vieux dicton :
« La paix nourrit, la lutte dévore ».
L’égoïsme pur régnait sur la vie publique."